
|
|
|
Plénières et semi-plénièresPlénières
 Structure as a Means to Discovery in the Modelling and Monitoring of Dynamical SystemsEleni Chatzi, Institute of Structural Engineering, of the Department of Civil, Environmental and Geomatic Engineering (DBAUG), ETH Zürich Through increasingly available data, today's structures comprise a cyber-physical character, which fosters refinement of our approach to modelling and managing these systems. Yet, pure reliance on data is often not sufficient. Black box schemes often struggle with the intricate dynamics and uncertainties inherent to advanced modelling tasks. This talk overviews an integrative framework that advances learning for dynamics simulations, monitoring, and digital twinning tasks by focusing on the use of appropriate representations. Central to this approach is the encoding of data into forms that effectively capture system behaviors, leveraging appropriate architectures, and hybridizing physics-based principles with machine learning. We discuss integration of structured representations and formal grammars to enable the characterization of dynamic behaviors and foster learning models that are interpretable, adaptable, and generalizable. This physics-enhanced paradigm enables efficient simulation of complex systems, whether in forward open-loop or closed-loop configurations, accommodating scenarios with or without integrated data. By exploring these representational strategies, this presentation outlines a roadmap toward resilient and self-aware systems.  Efficacité énergétique et réduction de l'impact environnemental : les défis de la sidérurgie face à la transition énergétiqueRaphaël Norbert, Responsable de l'équipe Procédés et Energie, ArcelorMittal Global R & D Dans un contexte de transition énergétique accélérée, l'industrie sidérurgique se trouve face à un défi majeur : optimiser son efficacité énergétique tout en réduisant son impact environnemental. Avec une consommation énergétique représentant près de 7 % de l'énergie primaire mondiale et des émissions de CO₂ atteignant environ 8 % des émissions industrielles globales, l'industrie sidérurgique constitue un secteur clé dans la transition énergétique. L'optimisation de son efficacité énergétique représente ainsi un levier stratégique, non seulement pour réduire son empreinte carbone, mais également pour améliorer sa compétitivité économique face aux enjeux environnementaux. Parmi les nombreux défis, la récupération et la valorisation de la chaleur fatale restent des enjeux majeurs, entravés par la nature intermittente et hétérogène des flux thermiques dans les procédés sidérurgiques. En effet, la complexité des procédés sidérurgiques repose sur des phénomènes thermodynamiques et mécaniques multi-échelles, impliquant des transferts de chaleur intenses, des réactions chimiques en milieu hétérogène et des écoulements multiphasiques couplés. De plus, contrairement aux industries à fonctionnement continu, la sidérurgie se caractérise par des cycles de production discontinus, des gradients thermiques importants et des variations rapides de régime. Ces dynamiques complexes rendent difficile l'optimisation de la récupération de chaleur, notamment sur les sources diffuses ou de basse température. D'importantes pertes persistent, en particulier dans les sous-produits solides (laitiers, brames, ferrailles de recyclage, etc.). A l'échelle des équipements, les travaux de modélisation thermique et thermodynamique permettent d'identifier les zones critiques où les pertes sont maximales et d'optimiser les systèmes de récupération. Toutefois, la captation et le stockage de la chaleur fatale dans des procédés discontinus nécessitent des solutions adaptées, capables de gérer des flux énergétiques instationnaires. Le développement de matériaux à changement de phase, de récepteurs thermiques haute performance ou encore de nouvelles architectures d'échangeurs compacts constitue des pistes intéressantes. Enfin, l'un des défis majeurs réside dans le déploiement industriel de ces solutions, encore limité par des coûts d'investissement élevés, une maturité technologique insuffisante et des contraintes d'intégration sur des infrastructures existantes. La convergence entre recherche, innovation et politiques de soutien sera déterminante pour transformer ces avancées en applications concrètes, faisant de la récupération de chaleur un pilier incontournable de la sidérurgie bas carbone. L'intégration réussie de ces solutions ne se limite pas à une simple optimisation énergétique : elle redéfinira durablement les standards de la sidérurgie vers un modèle plus résilient, sobre en énergie et compétitif. 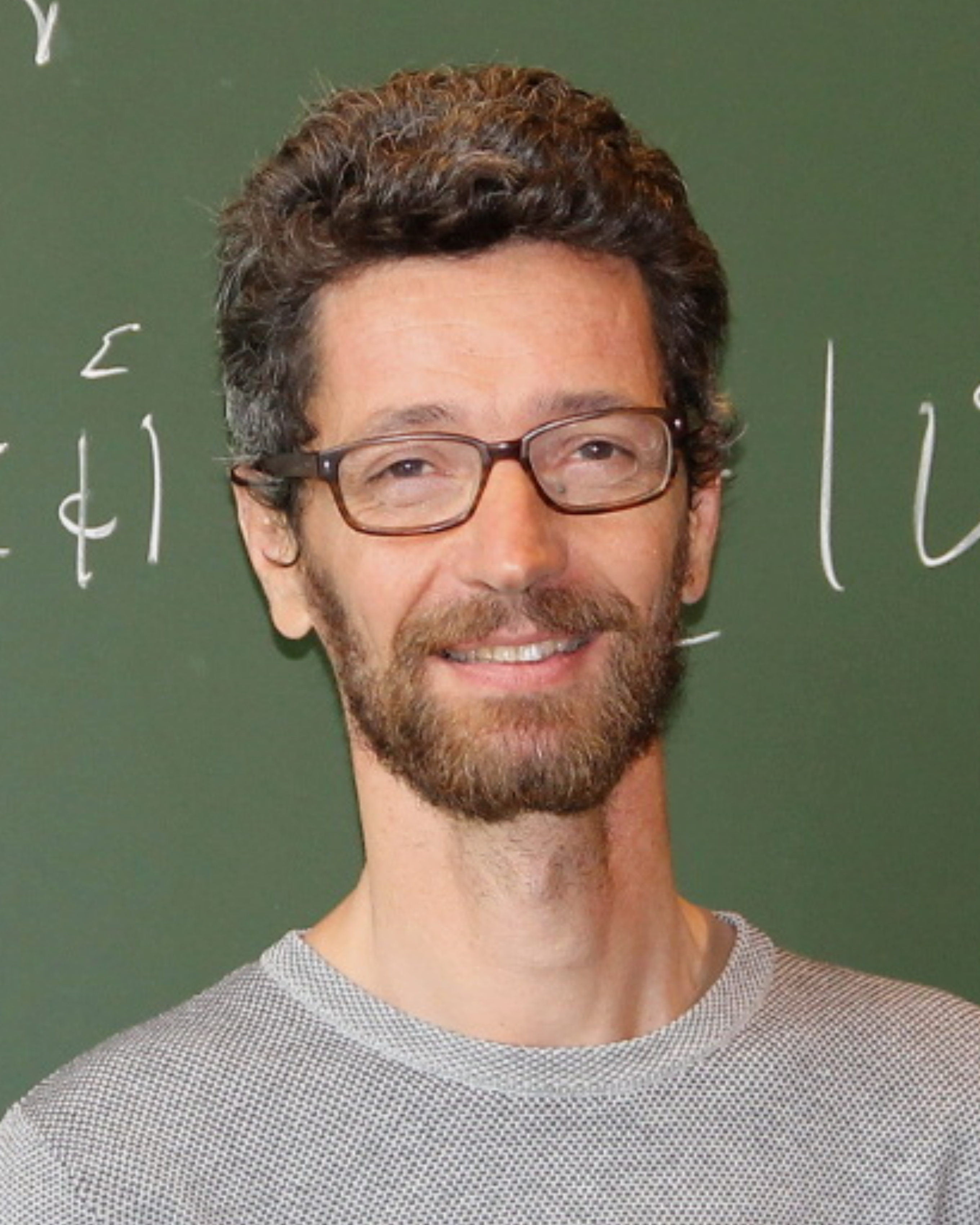 Mécanique des fluides pour l'environnement : de d'Alembert et Benjamin Franklin à nos joursStéphane Popinet, Institut Jean le Rond d'Alembert, CNRS & Sorbonne Université La mécanique est souvent associée à l'industrie. J'essaierai de montrer dans cette présentation que l'histoire de la mécanique des fluides est également étroitement liée à la compréhension (et au contrôle) des écoulements naturels : marées, mascarets, vagues, rivières. Des grands noms de la mécanique du 19ème siècle sont associés à ces développements : Laplace, Navier, Saint-Venant, Coriolis, Boussinesq. J'aborderai aussi les travaux récents, en particulier théoriques et numériques, qui nous permettent d'avancer dans la compréhension de phénomènes vitaux tels que les effets du réchauffement climatique sur la dynamique des atolls coralliens, les tsunamis d'origine volcanique et la modélisation des échanges entre l'océan et l'atmosphère aux échelles climatiques.  Damage and rupture of microcapsules in flow: How to characterize them numerically and experimentally?Anne-Virginie Salsac, Biomechanics and Bioengineering Laboratory (UMR CNRS 7338), Université de Technologie de Compiègne, CNRS, 60203 Compiègne, France Capsules, which are fluid droplets protected by a thin elastic membrane, are encountered in nature (red blood cells, phospholipid vesicles, etc.) and in various industrial applications. In the last decade, major improvements have been made in cosmetics and medicine for the controlled delivery of active substances, the new generations of mRNA vaccines being an example. When a capsule is placed in an external flow, it undergoes large deformations and potentially rupture, which, depending on the application, is to be avoided to preserve the internal content or promoted to allow the release of the internal substance. Experimental studies of the last decades mostly provided a common view on the occurrence of rupture. However, none of them provides insight on the evolution of the mechanical state leading to rupture. I will present a fluid-structure interaction numerical model and microrheological experiments designed to determine the mechanisms of damage and rupture of thin-walled structures immersed in Stokes flows. Semi-plénières
 Bedload transport by a laminar shearing flow: Experimental investigations and continuum modelingPascale Aussillous, Polytech Marseille, Aix Marseille Univ. - CNRS, IUSTI UMR 7343 Sediment transport is a natural phenomenon deeply involved in geo-morphology such as the formation and evolution of systems like channels, fans, and dunes. Recently, two-phase modeling has been developed to describe sediment transport using a continuum description of the granular phase which follows on from recent developments in dense suspensions and granular flows. I will present our experiments conducted in a rectangular channel to better understand the physical mechanisms governing sediment transport. We use refractive index-matched particle-fluid combinations to obtain detailed measurements of fluid and granular motion in the laminar regime. We then assess the ability of two-phase modeling to predict our experimental observations and infer the rheology of the sediment. Our study explores various flow configurations, the influence of particle softness, and the transition from viscous to inertial regimes.  Phénomènes transitoires en tribologieJuliette Cayer-Barrioz, Laboratoire de Tribologie et Dynamique des Systèmes (LTDS, CNRS UMR5513, Ecole centrale de Lyon), Ecully Les phénomènes transitoires en tribologie peuvent se produire en régime permanent et/ou dans des conditions variables dans le temps. En lubrification en particulier, et ce quel que soit le régime considéré, ces phénomènes peuvent entraîner une évolution locale du film lubrifiant, de la réponse en frottement ou des deux. Ces phénomènes temporels dynamiques sont liés à la dynamique propre de la sollicitation mais également à la réponse dynamique du film lubrifiant interfacial résultant de l'interaction de contact. L'analyse de ces effets transitoires donne accès à des informations cruciales sur l'interface de contact d'épaisseur sub-micrométrique soumise à des fortes pressions et à des cisaillements élevés, et contribue ainsi à la compréhension des mécanismes fondamentaux de frottement et de lubrification. La stratégie de recherche développée combine des approches expérimentales, numériques et théoriques. Elle couvre tous les régimes de lubrification : du régime de film mince complet pour lequel les surfaces déformées sont complétement séparées par un film de fluide sous pression cisaillé, au régime de lubrification dit limite pour lequel les surfaces sont en contact. Les échelles spatiales et temporelles considérées sont courtes : épaisseur de film allant du nanomètre à la centaine de nm et temps court devant le temps de résidence dans le contact, typiquement de quelques 0,1 ms pour des temps de contact de 1 ms. Cet exposé présentera quelques progrès récents en s'appuyant sur des illustrations soulignant le rôle des surfaces, en termes de topographie mais aussi de physico-chimie, et l'influence de la nature des fluides complexes séparant les deux surfaces en contact. Nous discuterons par exemple de l'effet de la rugosité sur la formation de jonctions entre surfaces lubrifiées en contact et nous montrerons comment nous avons corrélé l'origine physique du frottement macroscopique à la dynamique de ces jonctions.  Méthodes des éléments de frontière Rapides et Couplages Numériques : Vers des Applications Industrielles ComplexesStéphanie Chaillat, Laboratoire POems (UMR 7231 CNRS-INRIA-ENSTA) Les méthodes des éléments de frontière (Boundary Element Methods, BEM), basées sur la discrétisation des équations intégrales de frontière, se sont révélées particulièrement adaptées à la modélisation des ondes dans des domaines non bornés. Ces dernières années, des avancées significatives ont été réalisées dans la communauté BEM pour rendre ces méthodes applicables à des configurations réalistes, notamment grâce au développement de techniques rapides (méthode multipôle rapide, approximations de rang faible, adaptation de maillage) permettant de surmonter les contraintes de mémoire inhérentes à la méthode, en particulier le caractère dense de la matrice du système. Aujourd'hui, les BEM rapides sont arrivées à maturité et jouent un rôle clé dans la simulation de phénomènes multi-physiques, en particulier lorsqu'elles sont couplées à d'autres méthodes numériques comme les FEM. Cet exposé présentera les principes fondamentaux des BEM rapides, leur lien avec le big data et le machine learning, ainsi que les stratégies de couplage avec d'autres approches numériques pour résoudre des problèmes complexes. Les capacités de ces méthodes seront illustrées à travers diverses applications, y compris industrielles, telles que la propagation des ondes sismiques et l'acoustique sous-marine.  Modélisation particulaire de la fragmentation de solides à microstructure désordonnée poreuses, granulaires et cellulairesJean-Yves Delenne, INRAE, IATE, Université de Montpellier De nombreuses matières, notamment d'origine végétale, possèdent des microstructures poreuses, granulaires ou cellulaires. Que ce soit pour étudier la biomécanique des plantes vivantes ou pour optimiser l'utilisation de la matière végétale sous forme de fractions dans des aliments, matériaux ou composites biosourcés, il est essentiel de comprendre leurs propriétés mécaniques en lien avec leur microstructure interne. Les approches discrètes, qui représentent la matière non pas comme un continuum, mais comme un ensemble d'éléments distincts interagissant selon des lois spécifiques, constituent des outils puissants pour explorer l'origine microscopique de la déformation et de la rupture de ces matériaux. Si la méthode des éléments discrets est devenue l'archétype de ces approches, plusieurs méthodes complémentaires permettent d'affiner l'analyse des mécanismes en jeu à différentes échelles, notament lors de la rupture ou de la fragmentation. Dans cet exposé on présentera quelques-unes de ces méthodes ainsi que des travaux mettant l'accent sur le lien entre les échelles et le rôle clé de la microstructure. Nous nous interesserons à trois échelles : celle des phases et interfaces constituant les particules de matière, celle des mécanismes de rupture et celle des processus de fragmentation à l'échelle d'ensembles de particules.  Apport de la thermométrie pour l'étude de la tenue en fatigue des structures : application au procédé de fabrication additive arc-filCédric DOUDARD,Institut de Recherche Dupuy de Lôme (IRDL) - UMR CNRS 6027, ENSTA, Institut Polytechnique de Paris L'étude de la fatigue des structures nécessite la réalisation d'essais longs, coûteux et souvent limités en nombre d'éprouvettes. L'utilisation d'une instrumentation adaptée pour optimiser l'analyse des résultats de tels essais revêt donc un caractère essentiel. L'objet de l'exposé vise à montrer l'efficacité de l'utilisation de la thermométrie, via la thermographie infrarouge, pour la caractérisation de la fatigue des structures. Plus spécifiquement, les techniques expérimentales proposées permettent l'identification des points chauds, des mécanismes de rupture, le suivi in situ des fissures mais aussi la calibration de modèles de prévision de durée de vie, étape primordiale pour la mise en place de boucles d'optimisation notamment vis-à-vis des paramètres du procédé d'obtention. Dans le contexte de la fabrication additive, et plus spécifiquement dans celui du procédé arc-fil qui servira de fil rouge à l'exposé, les structures obtenues présentent classiquement une microstructure marquée par l'historique thermique, une population de défauts internes, un champ de contraintes résiduelles et un état de surface présentant de fortes aspérités. Si l'ensemble de ces éléments jouent un rôle important vis-à-vis de la tenue à la fatigue, l'état de surface est celui qui est souvent le plus pénalisant, de sorte qu'un traitement de parachèvement des surfaces (e.g., le martelage) peut être réalisé une fois la pièce obtenue. Ces traitements de parachèvement impliquent une modification de la topologie de surface mais aussi la mise en place d'un champ de contraintes résiduelles de compression en surface. Au cours de l'exposé il sera notamment montré comment la thermométrie sous chargements cycliques permet d'étudier et de modéliser la tenue en fatigue des configurations surface brute (i.e., à l'issue du procédé arc-fil) et surfaces parachevées.  Quelques apports de la géométrie différentielle dans la théorie des grandes transformationsBoris Kolev, LMPS, ENS Paris-Saclay La géométrie différentielle et la mécanique des milieux continus (MMC) ont une longue histoire commune depuis au moins la fin du XVIIIème siècle: Euler, Lagrange, Piola, Cosserat, Oldroyd, ... Une tentative de rationalisation du formalisme géométrique 3D de la MMC a été formulée par Truesdell et Noll au début de la seconde moitié du 20ème siècle. C'est elle qui est toujours utilisée de nos jours, notamment dans la théorie des grandes transformations. Il semble toutefois qu'une rupture radicale se soit produite dans les années 80 avec le développement des outils numériques et l'avancée rapide des moyens informatiques. Ce bouleversement a éclipsé de façon presque définitive le lien étroit entre la géométrie différentielle et la mécanique théorique. Par ailleurs, le concept traditionnel de "théorie scientifique" a été peu à peu remplacé par celui de "modèle ad hoc", compatible avec une plage plus ou moins restreinte de données expérimentales. Certains, peu nombreux et parfois isolés, ont malgré tout, maintenu ce lien étroit entre la géométrie différentielle et la mécanique théorique. On pourra citer, en particulier, et pour se limiter à la France, Jean-Marie Souriau avec ses nombreux apports sur le sujet (et en particulier la dérivation relativiste des principes fondamentaux de la MMC, qui apparaissent alors naturellement comme limite classique de principes issus de la relativité générale) mais également Paul Rougée qui a mis en valeur le rôle fondamental joué par l'ensemble des métriques riemanniennes dans la théorie des grandes transformations. Il semble toutefois y avoir un regain d'intérêt pour le sujet depuis une dizaine d'année. D'une part, le principe d'objectivité (ou d'indifférence matériel), qui est de première importance pour la formulation des lois de comportements, nécessite d'être mis en perspective avec le principe de covariance générale issu de la relativité générale. D'autre part, la notion de dérivée objective mérite d'être clairement et rigoureusement définie d'un point de vue mathématique. Cet exposé proposera quelques résultats et perspectives sur ces questions. On montrera, en particulier, après une exposition synthétique moderne du cadre géométrique 3D de la MMC que toutes les dérivées objectives correspondent en fait à des dérivées covariantes sur la variété de dimension infinie des métriques riemanniennes sur le Body. Cette formulation permet de les unifier toutes, rendant factice leur classification entre celles de type "dérivée de Lie" et celles de type "co-rotationnel". On esquissera ensuite un cadre géométrique 4D (introduit par Souriau) qui permet de formuler correctement la MMC relativiste. Ce cadre général est celui de la théorie de jauge, qui sert de base mathématique aussi bien à la théorie des champs (et notamment l'électromagnétisme) qu'à la mécanique quantique. Cette approche 4D, qui fait intervenir la covariance générale, est en effet essentielle pour mieux comprendre le couplage mécanique/électromagnétisme, en particulier en grandes transformations.  Stabilité des trains de bulles dans les boissons gazeusesDominique Legendre, Toulouse INP/ENSEEIHT/IMFT La dynamique collective de bulles a un rôle essentiel dans les écoulements diphasiques à phase dispersée observés dans de nombreuses applications industrielles, par exemple dans le domaine de la production d'énergie, le traitement de l'eau ou les procédés industriels. Dans la vie quotidienne, le temps de séjour et la taille des bulles produites lorsqu'une boisson gazeuse est versée dans un verre ont un impact direct sur le plaisir procuré par la boisson [1]. Selon la boisson gazeuse, différents comportements sont observés. Des trains de bulles très stables sont clairement visibles dans le champagne ou dans certaines bières, suivant une ligne verticale à partir des sites de nucléation microscopiques où les bulles se forment en continu. Dans d'autres boissons telles que le soda, les trains de bulles ne sont pas observés et les bulles se retrouvent dispersées dans le liquide. D'après les travaux sur les mécanismes d'interactions entre deux bulles sphériques propres [2], les trains de bulles ne devraient pas être stables et donc jamais observés, ce qui contredit les observations faites dans les flutes de champagne. Le but de cette présentation est d'expliquer les conditions de stabilité et d'instabilité des trains de bulles [3]. à cette fin, expériences et simulations numériques sont associées. Il est montré que la taille des bulles ainsi que le niveau de contamination de l'interface des bulles affectent la stabilité d'un train de bulles. La transition d'un comportement stable à un comportement instable résulte de l'inversion de la force de portance subie par une bulle lorsqu'elle interagit avec le sillage de la bulle qui la précède. Un diagramme de phase est proposé pour caractériser les boissons permettant l'observation de trains de bulles parfaitement rectilignes. [1] R Zenit, Rodriguez, 2018, Physics Today 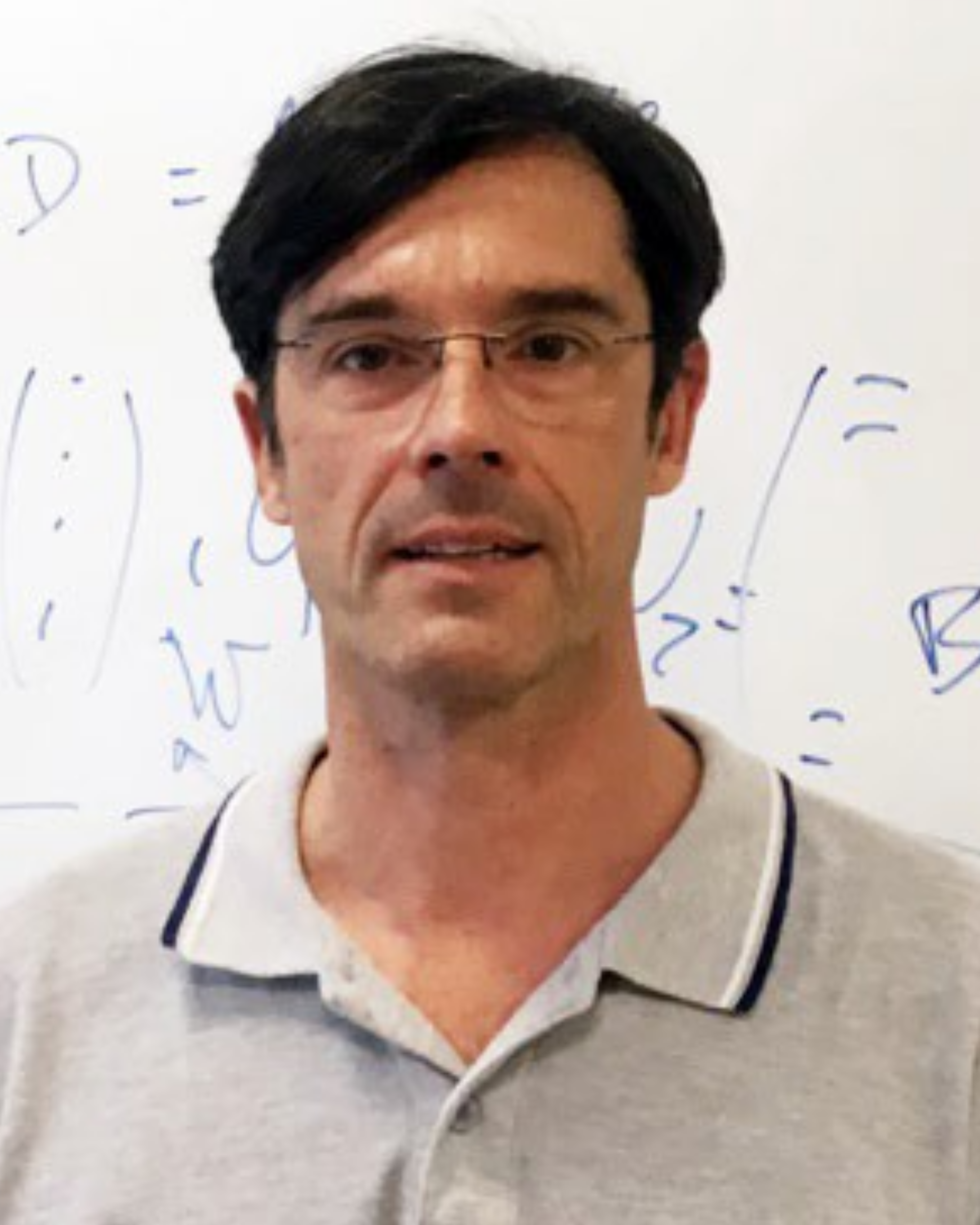 Une approche intrinsèque de la capillaritéOlivier Millet, Laboratoire des Sciences de l'Ingénieur pour l'Environnement (LaSIE) - UMR CNRS 7356 Dans cet exposé, nous présenterons une nouvelle approche intrinsèque de la capillarité basée des principes énergétiques et variationnels. On justifie ainsi rigoureusement de façon générale l'équation de Young-Laplace pour n'importe quelle géométrie de substrat solide. L'équation de Young ou de Yong généralisée, caractérisant l'angle de mouillage statique, est obtenue comme une condition limite naturelle associée. Cette approche permet également de donner une définition très générale de la force capillaire pour n'importe quelle géométrie de substrats solides et pour n'importe quel liquide en interaction. On présentera quelques applications possibles pour concevoir de nouveaux matériaux en optimisant leurs propriétés de mouillage.  Transition entre secondaire et supérieur : défis et enjeuxSaeed Paivandi, Laboratoire interuniversitaire des sciences de l'éducation et de la communication (LISEC), Université de Lorraine L'entrée à l'université des jeunes bacheliers tend à générer de nombreuses ruptures qui expliquent tant de difficultés vécues par un nombre important d’étudiants débutants. Les travaux de recherche à travers le monde révèlent la complexité des dimensions cognitives, métacognitives, sociales et existentielles de l’expérience de la première année de par le nombre important de nouveautés auxquelles l’étudiant devra s’ajuster. Les recherches montrent que la découverte des études universitaires est un temps de ruptures conjuguées, d'efforts et de mobilisation pour construire une autonomie plus importante, un nouvel engagement intellectuel, une nouvelle relation à l’apprendre, une nouvelle temporalité et de nouveaux repères et liens sociaux. Le rôle joué par l’environnement universitaire dans l’intégration académique et sociale des étudiant est devenu l’objet de nombreux débats critiques. En s’appuyant sur les recherches françaises et internationales, mon intervention tente de faire le point sur les enjeux de la transition entre secondaire et supérieur afin d’examiner la pertinence des dispositifs d’accompagnement mis en place par l’université, destinés à aider et à soutenir les étudiants primo-arrivants. Il s’agit de réfléchir sur les besoins, les défis et l’effet de l’environnement pédagogique sur le devenir étudiant. Référence : Paivandi, S. (2015). Apprendre à l’université. Bruxelles : De Boeck.  Interactions entre défauts et interfaces cristallines : effet de l'anisotropie élastiqueThiebaud Richeton, CNRS, Université de Lorraine, Arts et Métiers, LEM3, F-57000 Metz La déformation des matériaux cristallins peut se révéler d'une très grande complexité en raison des interactions à différentes échelles entre les défauts de la microstructure et de l'anisotropie du réseau cristallin. En particulier, un enjeu majeur consiste à améliorer la prédiction des champs mécaniques au niveau des interfaces matérielles comme les joints de grains. Ces interfaces jouent en effet un rôle très important dans la déformation et la rupture des matériaux cristallins. Elles sont souvent soumises à de fortes concentrations de contraintes, qui sont nécessaires afin d'assurer assurer la cohésion de la matière en présence de déformations incompatibles, ainsi qu'en raison de l'empilement possible des dislocations au cours de la plasticité. Les dislocations peuvent être bloquées, absorbées dans le joint ou transmises au grain voisin et sont soumises à des forces configurationnelles (ou forces images) attractives ou répulsives du fait de leurs champs élastiques. De plus, les joints de grains peuvent être le siège de phénomène de ségrégation chimique, ce qui va notamment affecter la résistance intergranulaire et leur capacité à migrer. Dans cet exposé, nous présenterons le formalisme de Stroh 2D et 3D en élasticité anisotrope hétérogène afin d'étudier successivement les interactions élastiques avec les joints de grains et les surfaces de défauts linéaires (dislocations), de défauts volumiques (modélisés sous forme d'inclusions sphériques possédant une déformation libre de contrainte ou « eigenstrain ») et de défauts ponctuels (atomes de soluté modélisés comme des dipôles élastiques ou moment d'ordre 1 de la distribution de forces ponctuelles représentant l'effet du soluté sur son voisinage). Les effets de l'anisotropie élastique, du type de défaut et de sa position par rapport à l'interface, de la désorientation du réseau, des caractéristiques des joints de grains et des surfaces (rigidité, champs élastiques) seront analysés. Concernant les dipôles élastiques, ceux-ci seront mesurés par statique moléculaire pour calculer les énergies d'interaction de différents solutés avec des joints de grains correspondant à des arrangements périodiques de dislocations. Ces énergies d'interactions seront comparées avec les énergies de ségrégation obtenues directement par statique moléculaire. 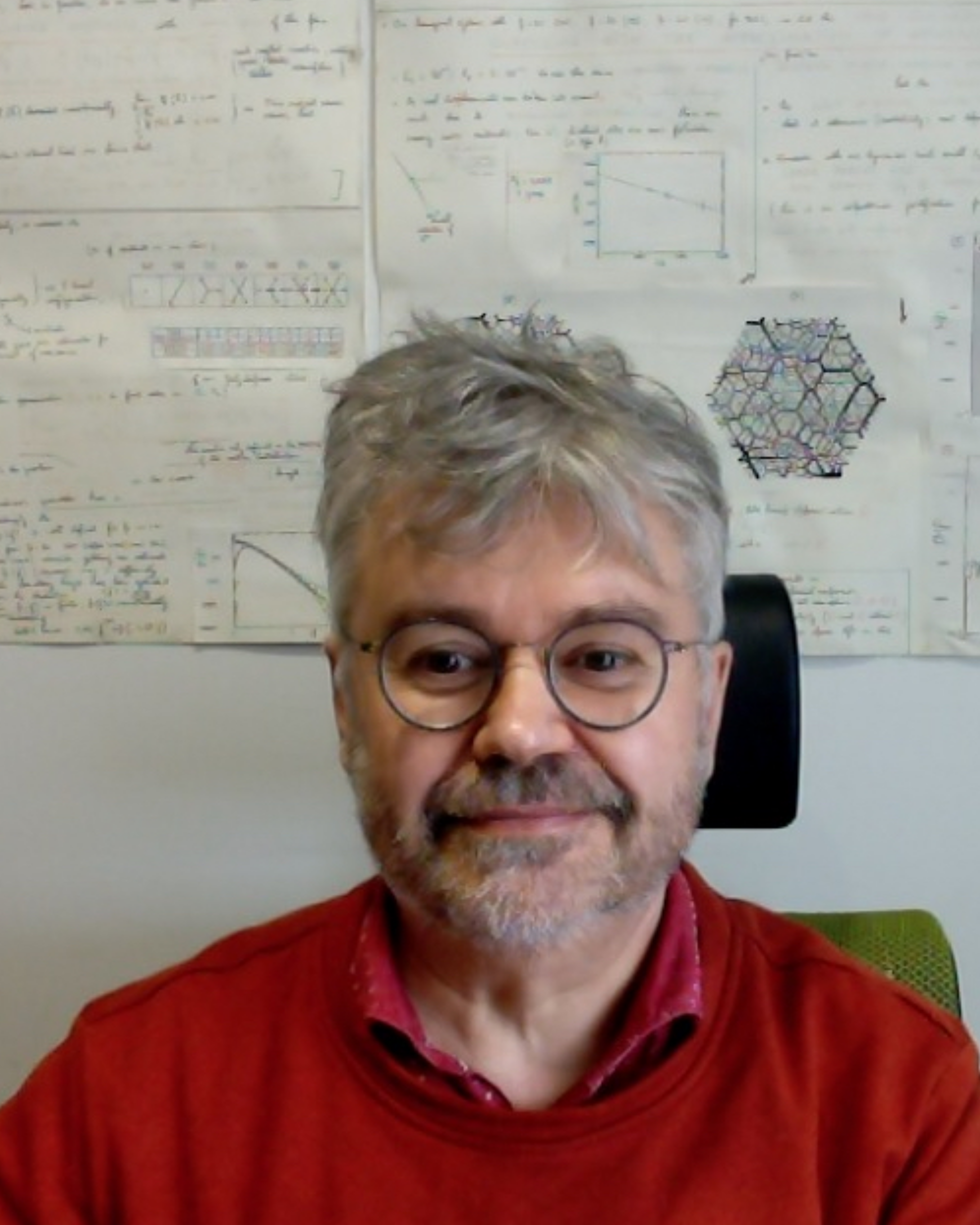 Microstructure et comportement mécanique des assemblages particulaires cohésifsJean-Noël Roux, Laboratoire Navier, UMR Univ. Eiffel - École des Ponts - CNRS La micromécanique des matériaux granulaires a connu dans les dernières décennies un essor considérable, qui s'est appuyé en particulier sur la simulation numérique de type "éléments discrets" (DEM), analogue de la dynamique moléculaire pour des grains macroscopiques. Le comportement en régime solide, quasi-statique, de ces matériaux, tel qu'étudié traditionnellement à l'échelle macroscopique en géotechnique, est éclairé par les approches micromécaniques, qui ont permis de revisiter des notions classiques tel que l' "état critique" (la structure d'écoulement et les propriétés correspondantes des matériaux accumulant de façon monotone la déformation plastique dans une direction donnée). La rhéologie des matériaux granulaires en écoulement a dans ce contexte bénéficié de la formulation de lois constitutives nouvelles et celle des suspensions a également été profondément renouvelée par la prise en compte du réseau des contacts entre les grains solides qu'elles contiennent. La modélisation micromécanique des mélanges de grains et de fluides est aujourd'hui une frontière très active de la recherche sur les matériaux granulaires. Il en est de même pour le domaine des assemblages granulaires cohésifs, qui peuvent former par agrégation des structures très lâches, et des états beaucoup plus variés que les matériaux sans cohésion, dont les propriétés mécaniques sont encore relativement peu explorées. L'exposé présentera les résultats d'une étude systématique par simulation numérique discrète des propriétés statiques et d'écoulement d'un modèle simple de matériau cohésif (cohésion par forces capillaires), dont seront soulignées les comportements génériques, communs à d'autres matériaux (notamment les systèmes colloïdaux). Comment caractériser et classifier les états internes, en introduisant des variables additionnelles à celles utilisées pour les matériaux sans cohésion (densité, coordinence, orientations des contacts) ? Comment décrire la plasticité sous l'effet de l'augmentation du niveau de contraintes, dont les effets sont importants pour les matériaux cohésifs, alors qu'en l'absence de cohésion elle se manifeste essentiellement lors des changements de l'orientation des contraintes ? Comment généraliser les lois constitutives décrivant les écoulements au cas cohésif ? Que devient, en présence de cohésion, les états critiques et leur approche ? Telles sont les questions auxquelles on apportera les éléments de réponse dont on dispose actuellement, en se fondant sur les résultats de nos recherches et ceux de la communauté dans laquelle elle s'inscrit.  Engineering Programmable Shape Memory and Morphing Polymers: From Mechanics to ApplicationsGiulia Scalet, Department of Civil Engineering and Architecture, University of Pavia, via Ferrata 3, 27100 Pavia, Italy Shape-morphing materials and structures are emerging as a key research area with applications spanning biomedicine, tissue engineering, drug delivery, soft robotics, and smart sensing. Among the various classes of responsive materials, hydrogels and shape memory polymers have shown great potential for developing programmable, adaptive systems. Despite significant advancements, achieving shape adaptability tailored to specific application constraints remains a major challenge. This talk will present our recent contributions to addressing this issue. In the first part of this talk, we will begin by exploring a promising class of thermos-responsive shape memory polymers with diverse shape memory effects, namely multi-phase semi-crystalline chemically cross-linked polymer networks. We will detail an integrated approach that simultaneously optimizes their composition, properties, and thermal activation of shape change, without relying solely on chemical modifications. This approach will be complemented by a flexible continuum modeling framework that captures the complex thermo-mechanical and shape-memory behavior of these materials. The model is validated against experimental data on different homopolymer and copolymer networks, providing new insights into their behavior. Additionally, we will present the first attempt to describe the photo-cross-linking process in these materials, offering a deeper understanding of polymer network formation. In the second part of the talk, a novel extrusion-based 4D printing technique for fabricating such materials will complete the presentation. This flexible approach will enable also the design of novel multi-material or gradient-based polymeric structures capable of controlled shape changes in response to immersion in liquid or thermal cycling. Finally, we will discuss representative applications of the proposed shape memory and morphing systems, with a particular focus on the biomedical and tissue engineering field, highlighting the transformative potential of these materials for the development of next-generation smart systems. Acknowledgments. This work was funded by the European Union ERC CoDe4Bio Grant ID 101039467. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them. |

